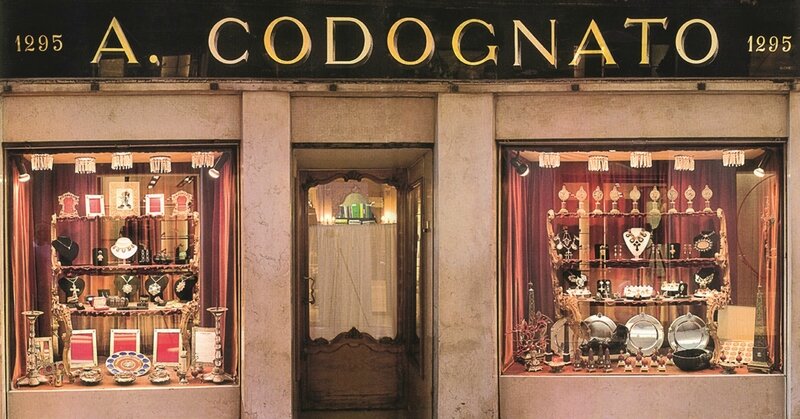Près de quinze ans après l'appel de l'intellectuel palestinien Edward Said à l'établissement d'un comité pour la vérité historique et la justice politique, l'association israélienne Zochrot lance les préparatifs de sa propre « commission de vérité publique ». Rendue célèbre début 2014 par le lancement de son application iNakba, qui permet de visualiser les villages palestiniens détruits en 1948, Zochrot ouvre un nouveau front dans sa lutte contre l'oubli des crimes commis en 1948 au nom d'Israël.
 Réfugiés palestiniens dans la région de Tulkarem.
CICR, 1948.
Réfugiés palestiniens dans la région de Tulkarem.
CICR, 1948.
Depuis l'annonce de la fin des neuf mois de négociations israélo-palestiniennes sous égide américaine, les initiatives se multiplient pour pallier l'échec des pourparlers. Devant le refus israélien de libérer le quatrième contingent de prisonniers, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a rapidement publié le 1er avril 2014 quinze demandes d'adhésion à des traités internationaux, relançant ainsi le débat d'une accession à la Cour pénale internationale pour juger des crimes de la colonisation israélienne. Tout aussi inattendue fut la signature d'un accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, qui a permis la formation d'un gouvernement d'union nationale largement composé de personnalités indépendantes.
Lutte contre l'oubli
C'est dans ce contexte qu'une organisation israélienne, inspirée par les précédents historiques sud-américains et la popularité de la Commission vérité et réconciliation sud-africaine, a entrepris de lancer une « commission de vérité publique », dont la première réunion publique aura lieu en octobre 2014. Instauré après une période de guerre civile ou de dictature, ce type de commission a, par le passé, permis dans différents pays de recueillir les milliers de témoignages de victimes que l'appareil judiciaire ne peut pas, ou ne veut pas, traiter. Quitte à faire l'impasse, dans un premier temps, sur la responsabilité pénale des criminels, elle fait parfois entendre des voix jusqu'alors inaudibles.
L'organisation à l'origine de ce projet, Zochrot (« Elles se souviennent » en hébreu), est une figure emblématique de la lutte pour le droit au retour des réfugiés à l'intérieur d'Israël. Alors qu'Israël a voté en 2011 une loi interdisant l'accès aux fonds publics israéliens pour toute association commémorant la Nakba [1] , Zochrot continue à tenir annuellement des conférences sur le sujet, et met à disposition des enseignants israéliens un « kit d'éducation à la Nakba » bien que ce mot ait été officiellement banni des livres scolaires en 2009 par le gouvernement de Benyamin Nétanyahou.
Ce petit groupe de militants de gauche, baséà Tel-Aviv, a par ailleurs lancé au cours de l'été2013 une application pour téléphone portable, iNakba, permettant de localiser sur la carte d'Israël les villages détruits par les milices juives [2] en 1948 et fournir des informations relatives à l'expulsion de leurs habitants palestiniens.
Après douze ans d'existence dédiés à informer le public israélien sur la réalité des crimes commis durant leur « guerre d'indépendance » en 1948, Zochrot a décidé de laisser la parole aux témoins de cette époque, Israéliens et Palestiniens. L'association se réfère aux programmes de « justice transitionnelle » [3] pour décrire le travail de sa commission. Cette dernière aura pour objectif de présenter publiquement les récits collectés en rapport avec les exactions israéliennes commises alors.
De la difficultéà rassembler des témoignages
La première audition publique se tiendra le 21 octobre prochain à Beer Sheva (Bir al-Saba'a en arabe), exactement 66 ans après l'opération Yoav qui permit aux forces israéliennes de s'emparer de cette ville, offrant un point d'accès, en plein désert du Néguev, vers Gaza et l'Égypte. Cet événement devrait, selon Debby Farber en charge de ce projet à Zochrot, constituer la première étape d'une série de « commissions vérité publique » que l'association compte organiser chaque année à travers Israël. Compte tenu de l'impossibilité pour les réfugiés palestiniens maintenus en exil à l'extérieur (Liban, Syrie, Jordanie) ou vivant en Palestine d'obtenir un permis pour se rendre sur le territoire israélien, l'association entend donner la parole en premier lieu aux anciens habitants de la région de Beer Sheva, qui sont restés en Israël après la destruction de leurs villages. La possession de documents israéliens (carte de résidence de Jérusalem ou citoyenneté israélienne) sera également une condition nécessaire pour les Palestiniens qui, au côté de personnalités étrangères et israéliennes, composeront le jury de la commission. Cependant, la plupart des survivants ne pourront participer, ayant à l'époque fui vers Gaza où ils demeurent aujourd'hui enfermés. Zochrot envisage donc d'obtenir de leur part un témoignage enregistré par vidéo et pense à les faire participer par visioconférence lors de la tenue publique de cette commission. L'engagement des Palestiniens en faveur du boycott de toute interaction avec des organisations israéliennes risque en l'espèce de limiter considérablement la participation de témoins résidants à Gaza ou en Cisjordanie.
L'autre difficulté que Zochrot devra surmonter pour mener à bien son projet est la collecte des témoignages d'anciens miliciens juifs ayant participé aux combats dans la région de Beer Sheva. En effet, l'ambition de cette commission est, selon ses propres termes, de constituer à l'occasion de ces rencontres publiques une mise en parallèle des récits des réfugiés palestiniens avec des combattants ayant servi dans la même zone. Cette ambition fait l'originalité de ce projet, alors que les informations sur la Nakba ne manquent pas, pour qui veut se donner la peine d'explorer le riche travail accumulé au fil des années. Que ce soit le travail des historiens palestiniens, le recueil de l'histoire orale des réfugiés ou la production des « nouveaux historiens » israéliens [4], la réalité de cette épuration ethnique se trouve largement documentée. Mais la volonté de Zochrot butte sur un scepticisme, pour ne pas dire une opposition, des anciens miliciens quant à l'intérêt de venir témoigner dans une telle enceinte. Ainsi, Zochrot n'a pour l'instant pu recueillir que deux témoignages d'Israéliens et commence à réfléchir à d'autres solutions, comme la lecture de récits de combattants, pour présenter au moins cinq témoignages israéliens durant cette première journée.
Pour inciter ces témoins à venir parler devant la commission, Zochrot a décidé de parler des «évènements de 1948»à l'occasion de cette commission, en effaçant la référence à la Nakba qui renverrait à une perception uniquement palestinienne de ces «évènements ». S'ils espèrent ainsi ne pas décourager certains Israéliens à les rejoindre, ils prennent le risque de mettre en péril le travail qu'ils effectuent depuis des années pour imposer le terme même de « Nakba » au sein de la population israélienne. Néanmoins, ils entendent se servir de cette occasion pour aborder la question de l'héritage de la Nakba et ses déclinaisons contemporaines car « la Nakba n'a pas cessé en 1948». Le choix du Néguev leur offre ainsi l'occasion d'inviter des associations palestiniennes comme Adalah qui viendront présenter la situation des communautés bédouines d'Israël et les politiques de « relocalisation » que l'État hébreu veut leur imposer, comme le plan Prawer-Begin, finalement abandonné en décembre 2013 face à la résistance des populations locales.
Une initiative à portée limitée
Le travail de Zochrot se situe dans la lignée d'autres d'initiatives récentes israéliennes. L'exemple de la campagne de Breaking the Silence, qui recueille le témoignage de militaires ayant servi dans les territoires occupés, semble avoir inspiré ces militants pour qui l'essentiel de leur travail est « de faire admettre la vérité, promouvoir la reconnaissance et la responsabilité (israélienne) pour faciliter un processus historique de justice et de paix ». Cet attachement à inscrire ce travail dans la société israélienne se retrouve dans un autre projet exposé en octobre 2012, qui fut à l'origine de cette commission, lancé par l'historien Ilan Pappe et le réalisateur Eyal Sivan. A common archive, Palestine 1948 a rassemblé les témoignages de plus de trente combattants juifs, ainsi que des archives vidéos, présentés dans le cadre d'une exposition aux côtés de témoignages de réfugiés palestiniens. On retrouve la même volonté de sensibiliser l'opinion israélienne dans la commission Zochrot qui est, pour ces organisateurs, l'occasion de « créer un débat public et obtenir plus de soutien auprès des Israéliens dans ce combat mené depuis des années ».
Également persuadés de la nécessité de porter à la connaissance du public la réalité de la colonisation israélienne, un collectif d'intellectuels avait, dès 2009, procédéà la création du Tribunal Russel pour la Palestine [5] . À l'époque, les membres de ce tribunal avaient dénoncé la relative indifférence qui entourait leur travail, notamment en Israël. Néanmoins, pour Debby Farber, ce risque n'est pas à craindre dans le cas de la commission Zochrot. Elle assure qu'en dépit de leurs moyens limités, leur statut de « cible favorite des organisations sionistes israéliennes » leur garantira une couverture médiatique plus importante, ne serait-ce que pour dénoncer cette initiative.
En spécifiant « ne pas être un tribunal, mais un forum informel » — contrairement à ce qui s'est produit dans d'autres pays où le recueil de témoignages a pu servir à l'établissement de procédures judiciaires adéquates — Zochrot court le risque de ne rencontrer que peu d'écho auprès des Palestiniens. Alors que ces derniers espèrent poursuivre les plus hauts responsables israéliens devant les tribunaux internationaux, les objectifs affichés par l'association israélienne ne semblent pas être en mesure d'appuyer leurs demandes. De plus, la commission se tiendra sans soutien étatique, conséquence de la volonté de s'établir en dépit de tout accord politique préalable. Ses défenseurs avancent que c'est l'occasion d'inventer une « nouvelle forme de justice transitionnelle, durant le conflit », faisant mine d'ignorer qu'historiquement ces « tribunaux des larmes » sont avant tout des outils du politique pour décréter la paix civile après une période de conflit interne ou de crimes de masse.
L'initiative de Zochrot témoigne de la détermination à ne pas laisser la réalité de la Nakba ignorée par le public israélien. Cependant, l'absence de soutien, tant du côté palestinien que d'instances publiques et la marginalité de ce type d'initiative au sein de la population israélienne risque de confiner cette « commission vérité publique »à une audience relativement réduite et déjà convaincue.
[1] Signifiant « catastrophe » en arabe, ce mot renvoie dans l'historiographie palestinienne à la destruction de centaines de villages et l'expulsion de plus de 700000 réfugiés qui n'ont jamais pu revenir sur leurs terres. Sa commémoration, chaque 15 mai, donne lieu à des manifestations dans les camps de réfugiés et dans les territoires palestiniens, violemment réprimés par les forces israéliennes. En 2014, deux adolescents palestiniens ont été abattus aux environs de la prison d'Ofer lors de ces commémorations.
[2] On parle ici de « milices » et de « miliciens » juifs puisque l'armée est, à la naissance d'Israël, composée des milices juives actives durant la période du mandat britannique. C'est également le terme retenu par Zochrot.
[3] Plébiscité par de nombreux activistes et intellectuels depuis une vingtaine d'années, ce terme regroupe l'ensemble des programmes mis en place en sortie de conflit pour tenter de répondre à des demandes diverses : écriture de l'histoire immédiate, révélation de l'ampleur des crimes commis et réparation. Les commissions vérité et réconciliation, celle instaurée après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud par exemple, en sont les principaux outils.
[4] Ce terme désigne les historiens qui, à l'instar de Benny Morris, Ilan Pappé ou Avi Shlaïm, pour ne citer que les plus connus, ont bouleversé l'historiographie israélienne à partir d'un travail sur les archives israéliennes et britanniques. Ils ont abouti à une remise en cause des mythes fondateurs du sionisme, en particulier ceux attachés à la création d'Israël et à la négation de la Nakba.
[5] Instauré en 2009, sur le modèle du tribunal d'opinion conduit par Jean-Paul Sartre et Bertrand Russel pour juger des crimes de guerre américains au Vietnam, ce tribunal a rendu des conclusions sans appel en 2013. Il était composé, notamment, de Stéphane Hessel, Leila Shahid, Raymond et Lucie Aubrac, Gisèle Halimi, Aminata Traoré, Angela Davis, Boutros Boutros-Ghali, Etienne Balibar, Judith Butler, Noam Chomsky, Norman Finkelstein, Eric Rouleau, Naomi Klein, Ilan Pappe ou Mohammed Bedjaoui.